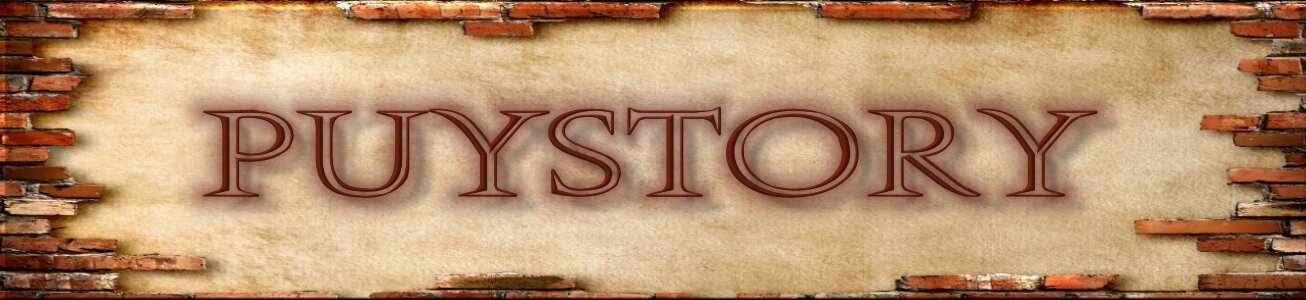La vie à bord de la Boussole et l'Astrolabe.*
En mer ou au mouillage, la vie quotidienne du bord est bien réglée.
Pour le repas, les officiers et les scientifiques s'habillent et prennent place autour d'une table dressée avec de la vaisselle de porcelaine ou d'étain.
Le menu est répétitif.
Le matin, le petit-déjeuner se compose de café, de pain, d'ail, de mélasse...
Au déjeuner et au diner, les rations sont à base de biscuits secs, de morue ou de viande salée, de choucroute ou de légumes séchés.
Des vivres frais comme de la viande, du poisson, des légumes ou des fruits améliorent parfois l'ordinaire et évitent le scorbut.
Le médecin veille sur la sante de l'équipage, l'aumônier sur celle des âmes et le commandant reste le seul maitre à bord (après Dieu, évidemment).
Mais que coûte une telle expédition en vivre ?
Quatre ans, c'est 4 x 365 = 1 460 jours.
Pour les 100 hommes de l'équipage, cela représente 1460 jours x 100 = 146 000 rations journalières de nourriture.
On peut estimer qu'un marin mange au minium 1 kg de nourriture par jour, ce qui fait pour tout l'équipage 146 tonnes à embarquer.
Il boit 2 litres par jour ce qui fait : 146 000 x 2 = 292 000 litres de liquide (eau, vin, rhum…).
Ces énormes quantités de nourriture embarquées dans des tonneaux, des caisses ou des sacs ne se conservent pas bien en mer du fait de l'humidité et de la chaleur.
Les escales sont les bienvenues pour renouveler l'eau potable et pour se ravitailler en fruits, légumes et viandes.
Les principaux dangers attendus et redoutés par l'équipage lors d'une telle expédition sont tout ceux qui peuvent entraver la bonne marche de l'expédition :
- mauvaise météo, - rencontres dangereuses, - accidents de toutes sortes, - révoltes ou maladies, - tempêtes, - brouillards, - manque de vent, - manque d'eau et de nourriture, - attaque de pirates, - attaque d'indigènes, - accidents lors de manœuvres, - échouage sur des récifs, - promiscuité, - dispute à bord, - mutinerie, - mal du pays, - maladies (dysenterie, scorbut).
Le scorbut ou "peste de la mer" se déclare au bout d'environ 70 jours de nourriture sans vitamine C (celle qu'on trouve en quantité dans les fruits et les légumes frais ou la choucroute).
Cette carence en vitamine C conduit à la perte des cheveux et des dents, à des hémorragies, au dépérissement et à la mort.
Lapérouse et son médecin Rollin sont sur la bonne voie pour empêcher le scorbut.
Ils font souvent escale pour acheter des légumes et des fruits frais (oranges, citrons), se nourrissent de choucroute et imposent un mode de vie hygiénique malgré les conditions de navigation difficiles.
Les bonnes relations avec les populations locales feront le succès de l'expédition pour l'approvisionnement des navires, l'aide à la cartographie des cotes, la connaissance de la flore et de la faune, mais aussi les futurs contacts commerciaux.
Afin de les amadouer et de montrer leurs bonnes dispositions, les navigateurs embarquent de très nombreux cadeaux à distribuer aux indigènes et à leurs chefs :
perles de verre, clochettes, outils de métal, hausse-col, décoration de casque de dragon et médailles commémoratives à l'effigie du roi et aussi des rubans en soie, des étoffes de mousseline.
Claude Nicolas Rollin, chirurgien à bord de la Boussole organise la vie quotidienne à bord et il dit :
"Le succès d’une longue expédition en mer repose sur la bonne santé de l’équipage.
La lutte contre le scorbut, cette "peste de la mer" due au manque de légumes et de fruits frais, est prioritaire.
J’ai suivi les conseils de Cook qui n’avait pas perdu un seul homme lors de ses voyages.
Nous embarquons donc des farines à base de carotte, raifort et persil, des légumes séchés, de la choucroute, le tout en grande quantité.
A chaque escale, nous faisons le plein de vivres frais et nous portons un soin particulier à l’hygiène : inciter les marins à se peigner, se laver, se raser, à changer régulièrement de chemise.
Et pour les conserver en pleine forme, nous les faisons danser tous les jours sur le pont !".
Les amoureux de Verdun. *
Entrez dans la tranchée des "Amoureux de Verdun" !
Découvrez la bande annonce de ce spectacle immersif émouvant créé en 2015 par les équipes du Puy du Fou comme un hommage aux Poilus de la Première Guerre mondiale.
Au fil de la correspondance amoureuse d’un soldat et sa fiancée, plongez au cœur de l’hiver 1916, dans une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques.
A la veille de Noël, les fumées envahissent les galeries, le sol tremble à chaque nouvelle explosion, les alarmes retentissent…
Tout semble perdu, mais en ce 24 décembre, les soldats ne savent pas encore qu’ils vont vivre un Noël qu’ils n’oublieront jamais !
Un spectacle immersif émouvant, élu "Meilleur Création Mondiale" en 2016.
La mode en 750.
Vers 750, la fourrure revient à la mode, mais pas pour tout le monde.
Les plus aisés se parent d'hermine, de loir (famille des Gliridae) ou de belette, dont les peaux sont rares.
Ils mettent de la fourrure partout, dans les capuches, dans la pelisse (cape se portant par-dessus un manteau), en doublure.
Ils la découpent aussi en bandes pour décorer le bord d'un vêtement.
Mais c'est surtout les populations du Nord qui, imitant les Germains, revêtent des peaux de bête lors des hivers les plus rudes.
À l'instar de cet article de luxe, la mode est plutôt sophistiquée.
Le costume se distingue de la sobriété romaine pour s'inspirer des traditions byzantines.
Couleurs chatoyantes, étoffes brodées de nombreux ornements.
Le corps est complètement enveloppé, le vêtement de coupe ample, est fait de tissus lourds et épais.
Il existe quelques tenues mixtes, comme la camisia (chemise), la tunique du dessous.
Hommes et femmes portent une cape par-dessus, la gonelle, maintenue par une agrafe (fibule) en bronze.

À l'époque des Mérovingiens, les hommes mettent sous leur tunique des braies courtes (formant une sorte de pantalon), maintenues par des lanières à hauteur du mollet.
Les cheveux sont courts et les barbes rasées.
Nous n'avons que peu de renseignements sur les vêtements des femmes d'alors, un peu plus sur celles vivant sous les Carolingiens.
Elles portent souvent deux robes, celle du dessus étant plus richement décorée, de pierres précieuses, de perles.
Des fibules ferment les deux vêtements.
Par-dessus leurs robes, les femmes ajustent une ceinture serrée à la taille.
Elles se couvrent aussi d'un voile.
ANGOISSE ET RÉCONFORT.*
Pour les hommes du Front, terrés, isolés dans un univers cauchemarde que de boue, de barbelés, de trous d’obus, il faut garder le moral et l’espoir.
Certes, il y a les solides amitiés qui se nouent entre compagnons de misère, mais ce qui les aide à survivre, c’est le souvenir de figures aimées.
Ils évoquent ceux restés "là-bas".
Les parents, les enfants, mais surtout la femme, leur femme, dont ils espèrent des nouvelles.
Aussi, celui que l’on attend avec impatience dans les casemates, c’est le vaguemestre et le courrier qu’il apporte.
Pour les poilus, seuls, sans famille, ceux que le romancier Henri Lavedan a surnommés les "mutilés du cœur", on invente les "marraines de guerre" qui leur écrivent régulièrement et les accueillent lors des rares permissions et, parfois, des idylles se nouent…
D’autres idylles naissent aussi dans les hôpitaux, entre patients et infirmières volontaires.
Ces "dames blanches" assistent les médecins, soignent et pansent les blessés.
Leur seule présence est un réconfort pour les "gueules cassées", ceux qui sont asphyxiés, aveuglés par les gaz, ceux qui sont percés de balles de mitrailleuses ou d’éclats d’obus, ceux qui devront être amputés.
Leur douceur et leur patience aident tous ces malheureux à reprendre goût à la vie ou, hélas, à mourir.
Au pays, on attend les nouvelles du Front avec la même impatience et on tremble.
Pour la femme, c’est l’angoisse de recevoir, un jour, un des fameux télégrammes apportés par la gendarmerie ou le Maire, celui qui annonce la mort de l’être cher.
Aussi, quel soulagement de voir arriver le facteur ou la factrice !
L’épouse lit la précieuse missive, le cœur serré.
Elle essaie de localiser le lieu où se trouve le soldat.
Mais la censure veille et interdit de donner toute précision.
Qu’importe, même si les nouvelles sont banales, même si les mots sont sans intérêt.
Ces quelques lignes dérisoires rassurent : il est vivant !
Et pour qu’il vive longtemps, elle prie sans cesse.
D’ailleurs, les églises accueillent de plus en plus de fidèles, avides de réconfort et d’espoir.
Des ex-voto (tableau ou objet symbolique suspendu à la suite d’un vœu ou en remerciement d’une grâce obtenue) couvrent les murs.
Des cierges brûlent devant les saints protecteurs, surtout devant Sainte Radegonde, la sainte patronne des soldats.
Des personnes, moins bien intentionnées, exploitent l’inquiétude des épouses : tireuses de cartes, voyantes et autres diseuses de bonne aventure qui prétendent lire l’avenir et proposent à prix d’or, des "gris-gris" censés protéger les combattants.
Un lien très fort s’établit entre les couples malgré l’éloignement,
Leurs pensées se rejoignent et les aident à croire au retour et parfois, c’est le choc, l’émotion indicible.
La porte s’ouvre, il est là, celui qu’elle n’osait espérer.
Certes, la permission sera courte, mais comme c’est merveilleux ces heures de bonheur arrachées à la guerre.
Elle s’achèvera, enfin, cette guerre avec un bilan terrible.
Des millions de morts, de mutilés, de survivants amers.
Les hommes doivent admettre que leurs femmes ont évolué en quatre ans.
Elles ont su prendre leur place au travail et n’entendent pas retourner à leurs fourneaux.
Elles ont changé d’allure.
Elles ont coupé leurs cheveux, raccourcissent leurs robes, portent le pantalon et fument en public.
Mais cette "libération" n’est qu’apparente.
En fait, même si leur rôle a été capital dans la victoire finale les femmes restent "inférieures", sans le moindre droit civil ou civique.
Le droit de vote, concédé par les députés en 1919, leur est retiré par le Sénat.
Il faudra, hélas, subir une autre guerre pour qu’elles deviennent des citoyennes à part entière.
Cueillette, chasse, pêche : des activités encore très présentes.*
Au Moyen Âge, la forêt est un espace de cueillette et une réserve de chasse sans équivalent.
La cueillette offre un complément végétal non négligeable (champignons, racines, plantes, châtaignes) alors que la chasse apporte viande et peaux (sangliers, cervidés).
Au Puy du Fou, des chasseurs s’illustrent étonnamment pendant le prélude du spectacle mais également lors d’une chasse à courre.
Privilège des nobles, cette chasse est surtout prétexte à entretenir son adresse.
Ainsi, le jeune adoubé démontre-t-il sa maîtrise à cheval et son habileté à l’arc en traquant le daim.
Enfin, la pêche reste une activité inhérente au quotidien des villageois.
Le point d’eau à proximité apporte des poissons une bonne partie de l’année.
Notons sur le site du spectacle, la maison d’un pêcheur, attenante au cours d’eau.
Celle-ci est dotée d’une avancée en bois qui surplombe l’eau et permet au villageois de maintenir en hauteur son filet de pêche.