26 février 2024
L'armée romaine
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F10%2F07%2F498088%2F133506888_o.jpg)
L'équipement du légionnaire était composé d'une gourde et d'un sac en cuir, d'une pioche et d'une hache, de ses armes, de son armure ou de sa cote de maille, d'un bouclier, etc. L'ARMEE ROMAINEDurant l'Antiquité, l'armée romaine est hiérarchisée, c'est-à-dire...
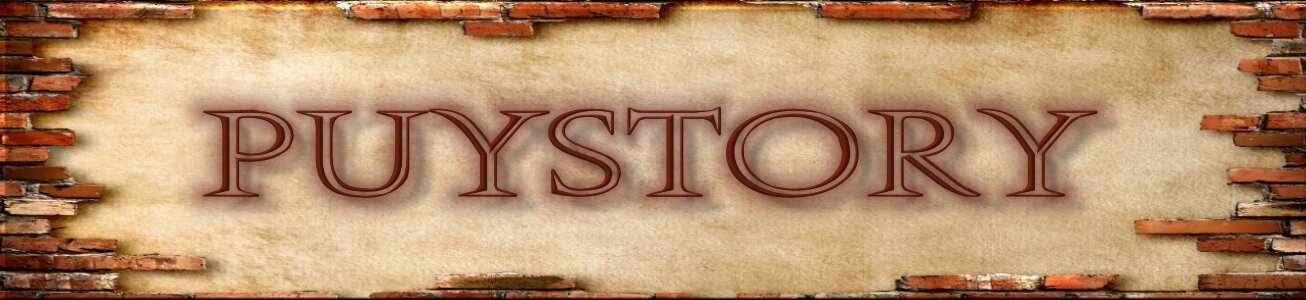


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F90%2F31%2F498088%2F131937115_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F57%2F61%2F498088%2F106784464_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F01%2F79%2F498088%2F80893037_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F35%2F498088%2F131834169_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F86%2F53%2F498088%2F131549082_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F70%2F35%2F498088%2F55149630_p.gif)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F22%2F19%2F498088%2F131240986_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F93%2F498088%2F106781755_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F99%2F54%2F498088%2F131783682_o.jpeg)