
Les navires de l’Âge Viking résultent de 6000 ans d’évolution technique.
Au Néolithique, les habitants des côtes danoises construisaient des pirogues (les plus anciennes datent d’environ 5 000 ans avant notre ère) dans un bois souple et résistant pour aller pêcher.
Utilisant des outils de silex, ils sculptaient des grumes de tilleul, bois tendre et résistant, jusqu’à obtenir une épaisseur régulière de 2 centimètres.
Ces pirogues "monoxyles", dont la longueur atteignait 10 mètres, s’aventuraient apparemment en mer, à la pagaie, pour la pêche à la morue, à la baleine, ainsi que pour de petites expéditions.
Certaines servirent de sépulture.

Puis, environ 3000 ans avant notre ère, ils commencèrent à creuser une rangée de trous, le long du bord supérieur de leurs pirogues.
À l’aide de cordes en fibres végétales, ils fixèrent dans la partie haute des flancs de la pirogue le bord inférieur d’une planche.
Ces planches supplémentaires augmentaient la navigabilité en surélevant le franc-bord.
Ainsi naquit la technique du bordé à clin, caractéristique de l’Europe du Nord.
Les navires scandinaves évoluèrent au cours de l’Âge du Bronze (2000 à 500 ans avant J.-C.).

Mais les bateaux ne sont pas encore en mesure d’affronter la haute mer.
Il fallut attendre la période précédant l’Âge Vikings (793 - 1066) pour que les charpentiers nordiques finissent par créer des bateaux aux proportions et aux propriétés poussées à l’extrême avec un rapport longueur sur largeur supérieur à six pour un (voire 11,4 pour un dans le cas du langskip d’Hedeby), en leur ajoutant de grands mâts et de puissantes quilles.
Les charpentiers vikings visaient essentiellement la vitesse.
Ils réduisaient l’épaisseur des bordages à deux centimètres seulement et éliminaient tout bois superflu des membrures.

Le bateau viking possédait une coque souple, à clins, qui suivait les vagues comme un être vivant.
On comptait une douzaine de chênes pour un navire de guerre de bonne taille (ou de sapins, surtout dans le nord).
Au large, les Vikings naviguaient le plus souvent à la voile, mais se servaient des avirons près des côtes et pour remonter les cours d’eau à l’intérieur des terres.
Les dimensions et les matériaux pouvaient varier en fonction du lieu de construction, des mers où ils naviguaient et des tâches pour lesquelles les différents modèles de bateaux et navires ont été développés : transport de marchandises, déplacements, servitude, guerre…

En 787 après J.-C., trois bateaux vikings, ou drakkars (nom donné usuellement au snekkja, bateau léger, non ponté), abordèrent au sud de l’Angleterre.
Ses occupants combattirent la population locale, débutant un conflit avec l’Angleterre qui durerait pendant des centaines d’années.

Les Vikings (ou Normands) étaient de grands navigateurs et, dès le 9ème siècle, ils avaient mis au point des navires faciles à manœuvrer, tenant bien la mer au cours des tempêtes, connus sous le nom de drakkars.
Le Drakkar était un compromis entre les bateaux à Voile et les bateaux à rames.
Leur légèreté leur permettait de rebondir sur les vagues.

Ils étaient rapides et leur tirant d’eau était si faible (90 cm) que les équipages pouvaient s’approcher de n’importe quel point de la côte et tirer leurs navires à terre, s’assurant ainsi que l’élément de surprise jouerait en leur faveur.
Les navires de guerre vikings avaient une proue élevée, à la courbe caractéristique qui est devenue le symbole des expéditions vikings.

La poupe et la proue étaient ornées de figures fantastiques.
La figure de proue avait un rôle magique.
Les Vikings croyaient aux génies des lieux, des créatures surnaturelles régnant sur un territoire, un fleuve, un rivage.

Les meilleurs bateaux étaient comparés à des dragons, des oiseaux et des serpents de mer.
Leurs dragons avaient pour fonction d’effrayer les esprits et d’impressionner les populations locales.
Leur gréement se composait d’une voile carrée et ils étaient de surcroît équipés de rames.
La combinaison de voiles et de rames leur donnait une grande adaptabilité, pour des raids fluviaux, comme pour de lointaines expéditions sur les océans.
Cette combinaison était le secret du navire Viking.
Un Drakkar mesurait 23,3 m de long pour 5,25 m de hauteur, pour un poids de 9 tonnes avec un mât de 10 à 13 m de haut.

Ils pouvaient transporter un équipage allant de 40 à 100 hommes et naviguer à une vitesse maximale de 12 nœuds (22 km/h).
Des tentes étaient parfois dressées pour se protéger de la pluie, mais le confort s’arrêtait là.
Aucune protection contre le froid, la pluie ou les embruns.

Les boucliers de l’équipage de marins-guerriers fixés sur les plats-bords permettaient une protection minimum contre les paquets de mer.
Les navires marchands, de taille et de forme variables (le Knarr), mais tout aussi aptes à la navigation, étaient utilisés pour commercer avec les pays lointains et pour transporter les émigrants en partance vers le pays de leur choix, mais aussi pour rapporter le butin amassé au cours des expéditions lointaines.

Les navires de guerre vikings étaient souvent nommés par le nombre de rames ou de bancs de rameurs.
Sexoeringr : 6 rames.
Tólfoeringr : 12 rames.
Fimtánsessa : 15 bancs de rameurs.
Tvitogsessa : 20 bancs de rameurs.
Le temps des Vikings aura duré près de trois siècles.
Débutant en 793 par le sac du monastère de Lindisfarne, il s’achèvera en 1066 quand Harald Sigurdarson sera battu devant York.
Cependant, le mot "drakkar" n’existe dans aucune langue scandinave, même si le Suédois connaît drakar, pluriel de drake : "dragon".

Même si de nombreuses histoires ont été transmises à travers les âges, très peu de drakkars vikings ont été découverts à ce jour.
Sans le bateau viking, l’ascension des Vikings ne serait jamais arrivée et leur style de guerre, né de leur aptitude à rapidement se propager, n’aurait été qu’un coup d’épée dans l’eau.
Les Vikings étaient certainement les marins les plus habiles de l’époque, navigant aux quatre coins du monde et atteignant des contrées aussi lointaines que l’Amérique, à l’ouest, et l’Asie Mineure, à l’est.

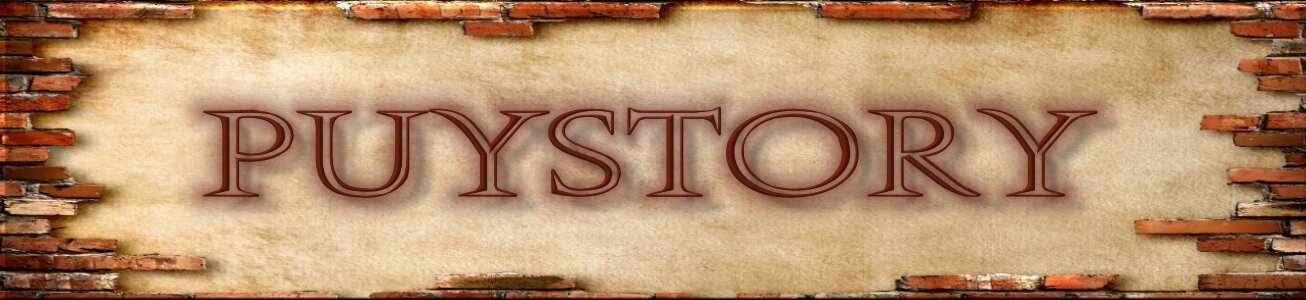
























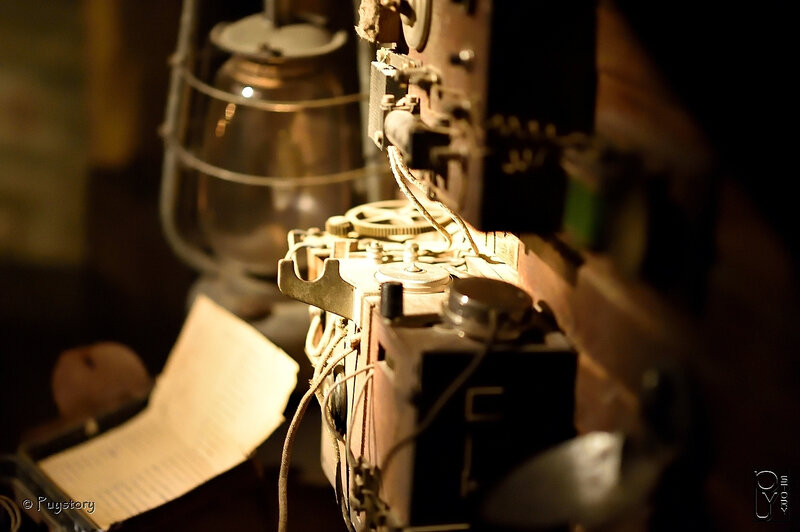






































/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F2%2F427243.jpg)